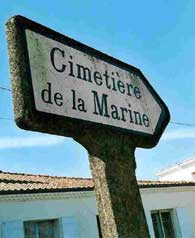|
| Plaque
Michelin de la R.N.11 historique à Soudan (photo: MV, mai 2015). |
Sources et documents: Atlas des grandes routes de France (Michelin, 1959); Atlas routier et touristique France, Michelin (2014);carte Niort-Châteauroux n°68, Michelin (1947); carte des Environs de Saint-Maixent (4e édition), Sardin (1897); Annuaire statistique du département de la Vienne, chez Saurin frères (1830); Coulombiers, de 1900 à nos jours, collectif d'auteurs, Cheminements (2003); «Evolution du paysage rural du département de la Vienne, de 1830 à nos jours», André Jollet, dans la revue Norois (1956); Guide Bleu de la France Automobile, Hachette (1954); Histoire de la ville et du port de Rochefort, T.1 et 2, J.T. Viaud et E.J. Fleury, éd. des Régionalismes (2002); Histoire de Niort 1, sous la direction de Daniel Courant, Geste éditions (2014); Histoire des routes de France, du Moyen Age à la Révolution, Georges Reverdy, Presses de l'ENPC (1997); La Charente-Maritime, sous la direction de Jean-Noël Luc, éditions Bordessoules (1981); La géographie illustrée de la France et de ses colonies, Jules Verne, Bibliothèque d'éducation, Hetzel (1876); La Guide des chemins de France, Charles Estienne (1552); La naissance de Rochefort sous Louis XIV, 1666-1715, Camille Gabet, Centre d'animation lyrique et culturel de Rochefort (1985); La plaine et la gâtine du Poitou dans les environs de Saint-Maixent, Parthenay et Niort: conférence faite à l'École militaire d'infanterie de Saint-Maixent, Jules Welsch, éditeur H. Charles-Lavauzelle (1908); «L'évolution urbaine de Niort», Julien Miquet, dans la revue Norois (1967); «L'histoire enfouie de Lusignan remonte à la surface», Philippe Bruyère, La Nouvelle République (2014); Mémoires pour servir à l’histoire de la ville et du port de Rochefort, Pierre-Philippe-Urbain Thomas, Faye (1828); Muron et ses environs, Frédéric Arnaud, C. Thèze (1898); Second mémoire sur la statistique des Deux-Sèvres, Etienne Dupin, P. Plisson (1801); Statistique du département de la Charente-Inférieure, Améric-Jean-Marie Gautier, G. Maréschal (1839); foyer-rural.muron.pagesperso-orange.fr; frontenayrr.fr; lusignan.fr; patrimoine-lacreche.pagesperso-orange.fr; saint-maixent-lecole.fr; ville-rochefort.fr; Wikisara; Wikipédia. Remerciements: la BPI du centre Georges-Pompidou, Gallica, CartoMundi, le Géoportail de l’IGN.
 |
| La Villedieu-du-Perron. Limite départementale entre la Vienne et les Deux-Sèvres (photo: MV, mai 2015). |
 |
| Autour de Mauzé-le-Mignon. La R.N.11 prend désormais en 2015 la direction de La Rochelle (photo: MV, mai 2015). |
| A NOS LECTEURS:
les photos, textes et dessins de ce site sont soumis au droit d'auteur. Pour
toute autre utilisation, contacter l'auteur. Merci de votre compréhension... |
Localités
et lieux traversés par la N11 (1959):
(Poitiers)
Coulombiers (D611)
Lusignan
Rouillé
La-Villedieu-du-Perron
Soudan
Saint-Maixent-l'Ecole
Kadoré
La Crèche
Niort (D811)
Montamisé
Frontenay-Rohan-Rohan
Le Pont
Epannes
Mauzé-sur-le-Mignon (D911)
Surgères
St-Germain-de-Marencennes
Muron
L'Ile-d'Albe
Rochefort
 |
| Anciens panneaux d'indication dans Mauzé-sur-le-Mignon (photo: MV, mai 2015). |
 |
| Vestiges
d'une borne de la N11 sur la départementale 911 non loin de
St-Germain-de-Marencennes (photo: MV, août 2007). |
 |
| A
Muron, un peu au nord-est de Rochefort, se trouve cette trace
de la route n°11 historique (photo: MV, août 2007) |
A VOIR, A FAIRE
Lusignan: patrie de la fée Mélusine et d’une puissante famille qui domina l’Orient au temps des croisades. Une promenade à faire entre les jardins qui recouvrent l’ancien château et les rues pavées du vieux centre où l’on trouvera une maison à pans de bois. On pourra aussi visiter l’église Notre-Dame et Saint-Junien (XIIe).
Saint-Maixent: les maisons anciennes dans le centre, la place du Marché, l’abbaye bénédictine, le musée du Sous-Officier…
Niort: le Donjon, reste d’une fortification voulue par Henri II Plantagenêt, les promenades dans le centre ancien vers le passage du Commerce et la rue Saint-Jean, la coulée verte le long de la Sèvre, le musée Bernard-d’Agesci.
Frontenay-Rohan-Rohan: l’église Saint-Pierre.
Mauzé-le-Mignon: les monuments en hommage à l’explorateur René Caillié, un des premiers Européens à atteindre et à revenir de Tombouctou au XIXe siècle.
Surgères: le «château», une longue enceinte fortifiée de 600 m et dotée de six tours, l’église romane Notre-Dame et sa belle façade vantée par Prosper Mérimée en 1841.
Rochefort: dans la ville ancienne, la place Colbert et les hôtels particuliers de la rue de la République. La Corderie royale (XVIIe) est l’un des restes de l’arsenal militaire. A visiter aussi, la maison de Pierre Loti, le musée national de la Marine, l’hôtel Hèbre de Saint-Clément et son musée d’Art et d’Histoire, le conservatoire du Bégonia…
|
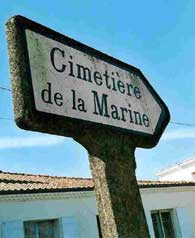 |
| Panneau
Michelin à l'entrée de Rochefort (photo: MV, août
2007). |
|
Belles
routes de France...
R.N.11: DU SEL ET DE L'AZUR
En 1959, la route nationale 11 relie Poitiers à Rochefort. Voilà un petit bout de route de 123 kilomètres qui ne manque pas de sel... Car l’histoire n’est pas banale: la chaussée doit son existence à la mer! En bout de course, se trouve donc Rochefort, le nouvel arsenal de guerre voulu par Louis XIV au XVIIe siècle. Le Roi-Soleil espérait ainsi rétablir sa puissance maritime et favoriser le commerce avec les colonies du royaume... Mais pour tracer la route, il a fallu vaincre les marais alentours, franchir le Mignon, la Sèvre Niortaise, la Vonne, le Palais… Traverser Surgères, Niort, Saint-Maixent-l’Ecole… Ce n’est pas tout à fait le Grand Bleu mais on a bien aimé virevolter jusqu’aux Demoiselles de Rochefort… Devant notre pare-brise, le grand écran, non?.
|
 |
|
La R.N.11 historique entre Surgères et Rochefort (Photo: Marc Verney, mai 2015). Pour retourner sur la page index, cliquez ici. |
Pour être tout à fait juste, la R.N.11 historique ne part pas exactement de Poitiers, mais un peu après Croutelle, au sud de l'agglomération poitevine. On quitte la chaussée de Paris à l’Espagne par un carrefour en forme d’échangeur aménagé vers 1959. L’intersection est d’ailleurs également mentionnée par la carte de Cassini (XVIIIe) publiée par le Géoportail de l’IGN. La voie (auj. D611) traverse le bois de la Marche et entre dans Coulombiers, le premier village traversé par la N11. On y traverse le Palais. Selon l’ouvrage Coulombiers, de 1900 à nos jours, les campagnes environnantes auraient été traversées par deux trajets antiques, l’une partant de Croutelle, passant par Cloué, Chenay et Melle, l’autre partant de Poitiers, passant Fontaine-le-Comte, Jazeneuil, Saint-Maixent. Cette dernière aurait, nous indique encore Coulombiers, de 1900 à nos jours, «laissé une trace dans la toponymie, il existe un lieu-dit appelé le "champ du Grand-chemin"». Plus loin, l'ouvrage nous dit encore que «l'axe routier le plus important de la région au XIIIe siècle, le "grand chemin chaussé aux pèlerins" en route vers Saint-Jacques passe par Coulombiers». Outre le fait que l’on y signale un relais de poste au XVIIe siècle, un texte de 1757, cité dans Coulombiers, de 1900 à nos jours, confirme à nouveau la présence d'une route importante en ces lieux: «un fourgon tiré par quatre chevaux, venant de Lusignan et se dirigeant vers Coulombiers, se renversa à environ cinq portées de fusil du bourg. Une passagère fut tuée sur le coup». Il y a cinq kilomètres entre Coulombiers et Lusignan. Peu avant ce village, on aura franchi la Vonne au pont de Pranzay. Il en est fait mention en 1830 dans l'Annuaire statistique du département de la Vienne. Dans ce document, la route de première classe n°11 y est indiquée «en chaussée d’empierrement» jusqu’à la limite du département.
 |
| A Rouillé, on peut voir cette plaque de la "route impériale n°11" (photo: Marc Verney, mai 2015). |
Lusignan est un bourg «pittoresquement bâti sur la crête d'un coteau» et dont les vestiges du château, nous dit le Guide Bleu 1954 sont «occupés par la mairie et l'école»... Pour suivre la route historique, il faut emprunter la départementale 150 qui pénètre au centre-ville. De là s’extraient deux axes importants: la R.N.150 (D150) qui file vers Melle et la R.N.11 (D611) qui s’oriente vers Saint-Maixent. La première voie fait partie de la route Paris-Bordeaux par Saintes aux XVIe et XVIIe siècles, comme on peut le lire dans La Guide des chemins de France (1552) de Charles Estienne, où, après Poitiers, on note les étapes de Lusignan, Brioux, Aulnay, Saintes, Mirambeau, La Garde-Rolland et Blaye. «L'épopée de la puissante famille des seigneurs de Lusignan, qui partirent du Poitou vers l'Orient où ils furent rois de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie (entre le XIIe et le XVe siècles) est au cœur du patrimoine de la ville de Lusignan», nous dit un article de Philippe Bruyère publié le 13 mars 2014 dans la Nouvelle République. En effet, un vaste château, propriété des Lusignan, dominait le bourg. Il était, nous dit le site lusignan.fr, «entouré d’une triple enceinte de hautes murailles. Ravagé lors du siège de 1574–1575 mené par le duc de Montpensier pendant les guerres de religion, il fut définitivement rasé par Richelieu au XVIIe siècle. Son emplacement fut aménagé, au XVIIIe siècle en jardin à la française par le comte de Blossac, l'intendant du Poitou».
En 1959, on quitte Lusignan par l’avenue de la Libération qui passe ensuite sous la ligne de chemin de fer de Niort, au Pont-de-Tôle. A Rouillé, le village suivant, la D611 porte le nom de rue de l’Atlantique. On se trouve là, en lisant l'article d’André Jollet titré «Evolution du paysage rural du département de la Vienne, de 1830 à nos jours», dans la région des «terres rouges à châtaigner», faite d'argile et très favorable aux cultures. «Vers 1830, les labours occupaient plus de 76% de la surface cultivée. L'aspect général du pays est celui d'un bocage. (...) Trois grandes routes, très anciennes, de Paris à Bordeaux, de Poitiers à Saintes et de Poitiers à La Rochelle et Rochefort ont permis, de bonne heure, d'exporter vers les régions voisines les produits agricoles et en particulier les grains. Les blés du plateau de Lusignan, Rouillé, Saint-Sauvant, vendus aux meuniers établis sur la Sèvre et ses affluents, étaient expédiés sous forme de farine vers Marans, La Rochelle, Rochefort et les îles de Ré et d'Oléron». Puis la route longe le bois de la Croix-Chaudron et traverse la Villedieu-du-Perron, on arrive dans le département des Deux-Sèvres.
Plus loin, sur l'un des versants de la Sèvre Niortaise, on trouve la cité de Saint-Maixent-l'Ecole, où l’on «fait (au XIXe siècle) principalement le commerce des farines et des bestiaux», découvre-t-on dans l'ouvrage de Jules Verne, La géographie illustrée de la France et de ses colonies. On lit dans le Second mémoire sur la statistique des Deux-Sèvres (1801) que la route de Paris à La Rochelle, ici, «est formée (à l’époque) de cailloux ou pierres ramassées, jusqu'à Saint-Maixent (...), le reste est en pierre calcaire de la plus mauvaise qualité. Elle est viable jusqu'à Saint-Maixent (...), les plus mauvais pas ont été réparés en l'an 9; mais il reste beaucoup à faire, les fonds ayant été insuffisants. Ensuite, jusqu'à Niort, elle est beaucoup moins viable, vu la nature du sol et la qualité des matériaux. De Niort à la limite, elle est très mauvaise (...). C'est surtout à Frontenay, Epannes et vers Mauzé qu'il faut travailler (...).Les plantations de cette route ne commencent qu'à la montagne de la Caille: delà jusqu'à Saint-Maixent, la route est bordée de beaux peupliers d'Italie et d'ormeaux». Une carte des environs de Saint-Maixent publiée par Gallica montre en 1897 «l’ancienne route de Poitiers» filant tout droit vers le lieu-dit La Lanterne alors que la chaussée plus récente contourne la colline par le sud avant d’entrer dans Saint-Maixent.
 |
| A La Villedieu-du-Perron en direction de Niort (photo: Marc Verney, mai 2015). |
A l’emplacement de Saint-Maixent, c’est un monastère, prospérant aux VIe et VIIe siècles, nous dit le site saint-maixent-lecole.fr, qui est à l'origine de la ville. Plus tard, les raids normands, des incendies et un tremblement de terre vident la région de ses habitants. Guerre de Cent-Ans et guerres de religion ravagent encore un peu plus les lieux. Il faut patienter jusqu'au XVIIIe siècle pour voir la situation s'apaiser durablement: en 1750, toujours d'après saint-maixent-lecole.fr, «le comte de Blossac, intendant du Poitou fait démolir la vieille porte Chalon et fait reconstruire la porte actuelle achevée en 1762. On lui doit aussi la place Denfert-Rochereau et la percée des avenues qui traversent la ville. Pendant la Révolution, la ville prend le nom de Maixent puis de Vauclair-sur-Sèvre». Depuis le XIXe siècle, on y trouve des écoles militaires. Et c'est l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (Ensoa) qui officie à Saint-Maixent depuis 1963. Rompez! D'ailleurs, la route file bien droit...
Après Kadoré, la chaussée franchit la Sèvre Niortaise peu avant La Crèche au pont de Vau. Là, nous signale Claude Raymond Noailles dans ses pages du site patrimoine-lacreche.pagesperso-orange.fr, une nouvelle chaussée menant à Niort y était en chantier en 1731. D’après ce site, l’ancien chemin descendait le long d’un coteau pour franchir le ruisseau des Fontaines au niveau du lieu-dit de la Basse-Crèche. Et remontait en direction de Saint-Maixent par l’actuel chemin des Diligences. La nouvelle route (actuelle avenue de Paris), carrossable à l’été 1750, file droit au dessus du ruisseau; là se bâtit peu à peu un bourg, la Haute-Crèche, dans lequel on remarque une vaste hôtellerie, le Chêne Vert, établie dans un bâtiment nommé la Capitainerie, qui sera la poste aux chevaux durant de nombreuses années. Pour arriver à Niort, il faut parcourir 9,5 km en ligne droite. La ville de Niort («nouveau gué»), doit son existence à sa situation, dans une boucle de la Sèvre Niortaise. Au Moyen Age, avec la dot d’Aliénor d'Aquitaine, la ville se trouve tout d’abord sous l'autorité du roi de France, puis, avec son remariage, dans les domaines du duc d'Anjou, qui est aussi roi d’Angleterre. Après diverses péripéties, Bertrand du Guesclin redonne définitivement Niort à la France le 23 mars 1372. Au XIVe siècle, ce sont les drapiers, les tanneurs qui font la réputation de Niort. C'est à la fin du Moyen Age que l'on creuse le port qui assurera l'essor commercial de la ville en la reliant à l'océan Atlantique. Réalisé sur ordre de Jean de Berry, le comte du Poitou, le port expédie en Flandre et en Espagne du sel, du poisson, du blé, de la laine et bien sûr des draps et des peaux, grande spécialité de la cité. Il faut savoir, voit-on dans l’ouvrage La Charente-Maritime, que «la côte de l’actuelle Charente-Maritime n’a pris sa configuration définitive qu’au XVIIe siècle. Durant tout le Moyen Age, le littoral a été en constante évolution. Des golfes s’enfoncent profondément à l’intérieur des terres, tel le golfe de la Petite-Flandre au nord de Rochefort». En 1808, explique-t-on sur la page Wikipédia de Niort, «Napoléon Ier prend un décret d'aménagement de la Sèvre niortaise afin de conforter son rôle de voie navigable. Ce décret est le premier acte ayant abouti à l'assèchement total du marais poitevin». Aujourd'hui, la ville est connue pour accueillir notamment le siège des principales mutuelles d'assurance françaises et est considérée comme la capitale de l'économie sociale française.
 |
| Plaque de cocher à La Crèche (photo: Marc Verney, mai 2015). |
 |
| On déniche cette plaque à Niort, à l'angle de l'avenue de Paris et de la place de la Brèche (photo: Marc Verney, mai 2015). |
Un article de Julien Miquet paru dans la revue Norois évoque l’évolution ancienne du réseau routier autour de Niort: au XVIIIe siècle, l’intendant Blossac, afin d’éviter l’embarras des noyaux urbains, va entreprendre la construction de chaussées qui longent les anciens centres fortifiés. Une action menée à Poitiers, Châtellerault (voir R.N.10 historique…) mais aussi à Saint-Maixent et Niort. Dans cette dernière cité, Paul Esprit Marie de La Bourdonnaye, comte de Blossac, fait tangenter la route Poitiers-La Rochelle-Rochefort par l’Est, «entraînant la destruction des murailles. (…) Dès le milieu du XVIIIe siècle, les foires quittent la place Chanzy, située au nord de la ville près de la porte Saint-Gelais et se fixent sur la nouvelle place de la Brèche (…) à l’intersection des axes Poitiers-La Rochelle-Rochefort et Limoges-Nantes». On quitte Niort par l’avenue de La Rochelle (D811), chaussée réaménagée après 1771, selon l’Histoire de Niort. A ce stade de notre promenade, les routes de Rochefort et de La Rochelle se confondent toujours. Au niveau de Bessines, la voie reprend son numéro D611. Juste après, la R.N.11 historique traverse Frontenay-Rohan-Rohan (il faut suivre la départementale 174E4). A la fin du XIIe siècle, raconte le site frontenayrr.fr, «Frontenay constituait l'une des puissantes forteresses féodales des Lusignan, comtes de la Marche. Liés aux deux monarchies, ceux-ci ne cessaient d'intriguer entre les souverains de France et d'Angleterre». Et Louis IX doit intervenir. «Malgré ses deux solides enceintes et l'héroïsme de sa garnison, rappelle encore le site de la mairie, Frontenay, assiégée par l'armée royale, capitula après quinze jours de sanglants combats, en juin de l'an 1242. En représailles, Saint Louis fit raser ses murailles et combler ses douves. L'amas de ruines dont seule émergeait l'église, à peine épargnée, reçut le nom de Frontenay-L'Abattue qui fut conservé pendant plus de trois siècles»... Ils ont de la rancune les rois de France! On rejoint la route de La Rochelle qui prend la direction du Pont.
Entre Le Pont et Epannes, la chaussée multivoies moderne qui prend ici le n°11 national coupe au plus court. L’ancienne chaussée (D1 et D1E1), qui apparaît sur la carte d’état-major du XIXe siècle publiée par le Géoportail, traverse au contraire les deux agglomérations. La route atteint désormais Mauzé-sur-le-Mignon. Le Mignon est une rivière, il faut le savoir... Sur le pont du Mignon, on n'y danse pas mais on y trouve (dixit le Guide Bleu 1954) le buste de l'explorateur et aventurier René Caillié (1799-1838), l’un des premiers Européens à entrer dans Tombouctou et natif des lieux. Relié à la mer par le canal du Mignon, Mauzé a connu jadis une activité commerciale intense grâce à son port, point de départ de la voie d’eau. «En 1714, raconte le site tourisme-deux-sevres.com, un ingénieur royal visite le port de Chaban et de Mauzé, menacé de ruine par le dessèchement des marais de Vix et de Choupeau. Un projet de canal, de halage et de cale pavée est examiné en 1808 par Napoléon 1er. De 1843 à 1845, le canal du Mignon est aménagé de l’écluse de Bazoin jusqu’au Port de Gueux (près de Sazay), puis prolongé de 1880 à 1883 jusqu’à Mauzé pour relier la commune à la mer par la Sèvre Niortaise et permettre le transport par gabare et chaland de bois, vins, farines, produits maraîchers et étoffes. Rapidement concurrencé par le rail, puis la route, le plus grand port de la "Venise Verte" est bientôt abandonné».
 |
| A la sortie de Mauzé-sur-le-Mignon (photo: Marc Verney, août 2007). |
 |
R.N.22:
LA PALLICE NOUS VOILA...
Jusquà La Rochelle, voici la courte route nationale 22. On avance facile vers la mer au travers de paysages agricoles prospères et tranquilles (lire) |
A Mauzé également, l'actuelle N11 (R.N.22 de 1959) à quatre voies s'en va vers l'ouest pour desservir La Rochelle. L'embranchement vers Surgères au départ de Mauzé ne fait que 1720 m dans le département des Deux-Sèvres. Voici ce qu'en dit le Second mémoire sur la statistique des deux-Sèvres (1801): «Cette route est en pierrailles calcaires, ramassées dans les champs et assez bonnes. Elle est rouagée, mais susceptible d'être réparée et remise dans un état viable, à peu de frais. Point de ponts. Quelques plantations d'ormeaux». Ici, plusieurs dizaines d’années plus tôt, nous dit Georges Reverdy dans l’Histoire des routes de France, du Moyen Age à la Révolution, «l’approvisionnement de Rochefort entraîna la construction de la nouvelle route directe de Paris à Rochefort par Mauzé et Surgères. Elle avait d’abord été ouverte de Mauzé à Surgères, et, en 1780, l’ingénieur en chef Duchesne avait fait approuver les alignements de Surgères à Rochefort». La route (D911) entre dans le département de la Charente-Maritime (anciennement Charente-Inférieure). Surgères se situe à l’est de la plaine de l'Aunis. La ville, nous informe la page Wikipédia de la cité, naît en raison des raids vikings qui ravagent les côtes de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou au IXe siècle. Pour défendre les marches du Bas-Poitou, alors sujet à ces attaques, «le comte du Poitou fait édifier vers la fin du IXe siècle ou au tout début du siècle suivant un premier fortin en bois avec installation d'une garnison afin de dissuader ces hommes du nord de piller la province». La Gères, qui traverse la cité, est canalisée durant le Moyen Age, au site du Gué-Charreau, afin de concurrencer les ports de Tonnay-Charente, sur la Charente, et de Saint-Jean-d'Angély, sur la Boutonne. Mais au XIVe siècle, le projet avorte sous la pression des seigneurs de La Rochelle. Après la rude guerre de Cent Ans qui voit Surgères basculer dans le camp anglais, Louis XIV ordonne la démolition des vastes fortifications.
 |
| L'arrivée à Surgères, en arrivant de Rochefort... Le nez dans les arbres (photo: Marc Verney, mai 2015). |
Plus tard, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Surgères se transforme profondément. En effet, la création du port de Rochefort et de son arsenal militaire sur la Charente voit la nécessité d’une liaison routière directe avec la capitale. Surgères est donc traversée par la nouvelle route royale qui parcourt le marais de la Petite-Flandre, mis en valeur dès le début du siècle par des ingénieurs hollandais. Ce sont ces derniers qui construisirent la levée sur laquelle passera la voie royale de Rochefort à Paris au XVIIIe siècle. En sortant par la chaussée de Rochefort, on croise l'ancienne commune de Saint-Pierre-de-Surgères qui a été annexée à Surgères en 1851. Le faubourg Saint-Pierre s’est développé autour d’un ancien village formé le long de la route de Rochefort. Sur la carte de Cassini (XVIIIe), publié par le Géoportail de l’IGN, un ancien tracé semble se déployer de là jusqu’à Muron, notamment autour de Saint-Germain-de-Marencennes. On se souvient que Georges Reverdy indique que les alignements de Surgères à Rochefort n’ont été approuvés qu’en 1780... D’ailleurs, on remarque, en lisant l’ouvrage La Charente-Maritime, que dans cette région, «des travaux considérables sont menés (dans le marais de la Petite-Flandre, NDLR) entre 1782 et 1785. L’assainissement –lutte contre le paludisme- mobilise 3000 à 4000 soldats, on construit 58 km de digues, 67 km de canaux». Nul doute que les voies de communication profitent aussi de ces travaux considérables.
Un peu plus loin, la route de Rochefort entre donc dans le village de Muron par la rue de la Libération. Des fouilles, effectuées lors de la réalisation de la déviation du bourg, dans les années 90, ont révélé la présence d’un village gallo-romain situé –à l’époque- en bordure de mer, nous dit Annie Bolle dans des «Notes archéologiques» parues sur le site du foyer rural du bourg. Une ordonnance royale, parue le 7 mars 1837, réunit Muron et la commune aujourd'hui totalement disparue de Saint-Louis-la-Petite-Flandre, ainsi nommée en raison de la présence de plusieurs familles flamandes «pour travailler au dessèchement du marais» au XVIIe siècle, nous dit la Statistique du département de la Charente-Inférieure. A noter qu’il existerait ici une ancienne voie attribuée à Charlemagne, le «chemin Charles» qui a relié Muron à Tonnay-Charente, plus au sud. Entre L'île-d'Albe et Rochefort, nous voici au cœur de la Petite-Flandre. L’Ile d'Albe est un hameau important installé sur un coteau au centre des marais. Il remonterait à une haute antiquité. En effet, dans des parchemins du Xe siècle, on trouve en langue latine la mention de Insula Alba d’après l’ouvrage Muron et ses environs. Son point culminant atteint 17 m au-dessus des marais. Du côté ouest, il existe une falaise escarpée où les vagues de la mer venaient se briser. Le livre Mémoires pour servir à l’histoire de la ville et du port de Rochefort (1828) nous explique que la route, «peu fréquentée, surtout à cause du mauvais état des chemins dont une partie traverse le marais», fut rangée parmi les voies de troisième classe, mais qu’un «décret du 16 décembre 1811 l’a déclarée de nouveau route de première classe». De fait, visuellement, la chaussée n’est pas très visible sur la carte de Cassini publiée par le Géoportail de l’IGN… Alors qu’elle est très nettement tracée sur la carte d’état-major du XIXe publiée par le même site.
 |
 |
| A
gauche, cette borne de la N11 était installée entre Lusignan
et Poitiers. A droite, dans le centre de
Rochefort, cette ancienne et mignonne plaque. L'intendant de marine Bégon est à l'origine de l'introduction en France du... bégonia (Photos: Marc Verney,
mai et août 2007). |
Rochefort, la ville-arsenal est bien vite atteinte. «Ancien port militaire, la ville a été construite sur un plan régulier au XVIIe siècle», nous raconte le Guide Bleu 1954. En effet, l’Histoire de la ville et du port de Rochefort nous précise que la cité est composée de «dix rues dirigées du nord au sud et traversée de l’est à l’ouest par quatorze autres», formant «61 îles et trois places bordées de maisons bien alignées. Toutes les rues sont spacieuses, trois d’entre elles ont de 18 à 20 m de largeur». Voulu par le roi Louis XIV, le port de guerre de Rochefort n’a été bâti qu’au prix de longs efforts, de 1666 à 1715. Il s'agit alors, nous dit le site ville-rochefort.fr de rétablir la puissance maritime royale et de favoriser le commerce avec les colonies. Le livre de Camille Gabet, La naissance de Rochefort sous Louis XIV, nous raconte qu’avant le site militaire, il y avait ici «juste un petit bourg groupé autour d’une église et quelques hameaux». Liée à l’inexorable envasement du port voisin de Brouage, la construction de la cité, située au bord de la Charente, commence fin 1665, avec, nous explique l’Histoire de la ville et du port de Rochefort, «le dessèchement du marais, le défrichement de la grande garenne de l’ancien château… Au mois de mai 1666, on peut tracer sur le sol transformé les plans des établissements d’abord indispensables», comme la corderie royale, pièce maîtresse du nouvel arsenal. Entourée de remparts à la fin du XVIIe siècle, la ville prend son aspect définitif, indique encore ville-rochefort.fr, avec Michel Bégon, l'intendant de la Marine de 1688 à 1710, qui organise la reconstruction des maisons en pierre de taille. Hélas, au début du XXe siècle, l’arsenal ne peut plus recevoir les nouveaux cuirassés et sa fermeture est effective en 1927… Ce fut aussi plus récemment la scène principale d'un célèbre film musical de Jacques Demy, les Demoiselles de Rochefort, avec Catherine Deneuve et Françoise Dorléac... Joli clap de fin pour la N11, non?
 |
| L'arrivée à Rochefort (photo: Marc Verney, mai 2015). |
Marc Verney, Sur ma route, novembre 2015
Retour à la page principale (clic!)
 |
R.N.10:
AUX BASQUES DE LA GIRONDE...
Au compteur de la 4CV, le trajet Paris-Hendaye, ša fait "Ó l'aise" plus de 750 km km depuis la porte de Saint-Cloud. Une sacrée promenade... (lire) |
|